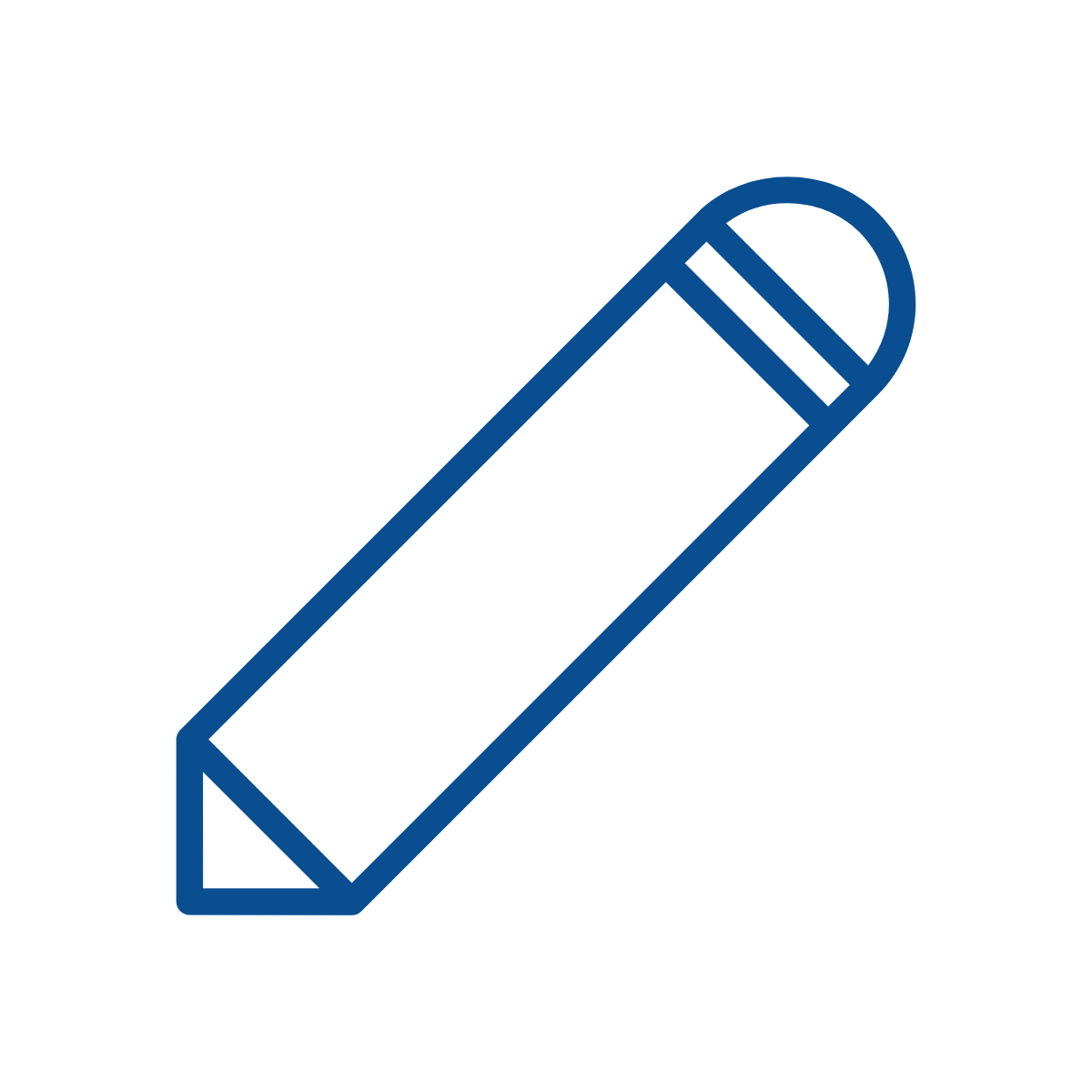Dans la même rubrique
-
Partager cette page
Christian Patouraux : un Alumnus en orbite
Près d’un quart de siècle déjà que Christian Patouraux, 50 ans, est entré dans l’univers des satellites. Basée à Singapour, sa start-up Kacific Broadband Satellites entend, après la mise en orbite de son satellite, couvrir les besoins en télécommunications de 600 millions de personnes d’Asie-Pacifique.
Rescapé du tsunami de 2004 en Thaïlande, Christian Patouraux est un homme de défis, d’une ténacité à toute épreuve. Basée à Singapour, sa société Kacific lancera le 17 décembre un premier satellite, «embarquant» pour $600 millions de contrats!
- À votre arrivée à l’École, en 1987, étiez-vous déjà déterminé à vous engager dans une carrière qui vous emmènerait à des milliers de kilomètres de la Terre ?
Christian Patouraux: «Pas du tout. J’ai toujours eu envie de comprendre comment fonctionnent les choses, surtout les moteurs, les trains, ce qui fait de la fumée et du bruit (sourire). Mais je me suis engagé dans les études d’ingénieur civil sans vraiment savoir à quoi m’attendre! Mon père est Français, c’est un ancien pied-noir d’Algérie, où il avait entamé des études d’ingénieur qu’il a dû interrompre suite à l’indépendance... Il m’y a certainement poussé et j’ai foncé, par défi: je voulais suivre un cursus ardu et montrer que je pouvais y arriver. Or je n’étais pas très fort en maths, à tel point que des professeurs de secondaires avaient parié que je n’y arriverais pas! Je n’ai pas eu facile au début, je le reconnais. Mais, petit à petit, j’ai découvert que je suis d’une ténacité à toute épreuve. Arrivé aux masters, quand les études sont devenues plus pratiques, j’ai découvert la thermodynamique, les moteurs d’avion, l’aérodynamique... J’étais comme un poisson dans l’eau! Ma vocation était née. Mon diplôme en poche, en 1992, j’ai postulé à l’Institut von Karman de dynamique des fluides, un nouveau défi! J’y ai obtenu le Diploma Course in Fluid Dynamics. Ensuite, j’ai été un des derniers à accomplir son service militaire (rires)! Suivant les conseils de personnes de l’Institut, j’ai rejoint l’École Royale Militaire où j’ai pu travailler sur pas mal de choses, comme la stabilisation des missiles.»
- Mais alors, quand avez-vous guidé votre premier satellite ?
Ch.P.: «Peu de temps après... J’ai débuté dans l’IT à Luxembourg, sans grande passion. Jusqu’à ce que je trouve un job en 1995 dans la Société Européenne des Satellites (SES). C’était incroyable! J’avais l’impression d’être dans un James Bond, contrôlant des satellites depuis mon téléport... Imaginez: jeune ingénieur, vous envoyez des commandes à des machines en orbite dans l’espace qui valent $250 millions (sourire)! Je m’y suis spécialisé dans la navigation et la propulsion des satellites, en grande partie à Los Angeles, dans l’usine de Hughes Aircraft Company, devenue Boeing. J’y suis resté huit ans. Devenu ingénieur en chef, j’avais lancé sept satellites et l’envie m’est venue de vivre de nouvelles expériences et d’avoir plus d’impact dans ma vie professionnelle. Je me suis alors inscrit à l’INSEAD, à Fontainebleau, mais j’ai décidé de poursuivre ces études sur leur campus de Singapour pour son ambiance plus communautaire. Avec ce nouveau diplôme en poche, en 2003, je me suis lancé dans la consultance. Mais j’étais perdu après l’INSEAD, je ne savais pas dans quelle direction m’investir...»
- Quel élément déclencheur vous a-t-il poussé à vous lancer dans cette folle aventure d’acquérir une fusée, un satellite et d’envoyer le tout dans l’espace ?

- L’aventure Kacific n’a toutefois démarré qu’en 2013; quel a été votre parcours les huit années qui l’ont précédée ?
Ch.P.: «Après la Thaïlande, j’ai repris les rênes d’une start-up que j’avais créée à Singapour, spécialisée dans les hot-spots wifi. Elle vivotait cependant et j’ai mis la clé sous le paillasson en 2008, en pleine crise financière. J’ai alors redémarré la consultance pour différentes boîtes, parmi lesquelles Airbus ou Boeing. Je suis ensuite devenu Chief Development Officer pour un opérateur qui levait $1 milliard pour lancer huit satellites, puis Head of Special Projects pour Measat en Malaisie. J’y ai appris énormément! En 2013, j’étais un peu à la croisée des chemins. Je me baladais à vélo à Singapour avec un ami, responsable d’un petit fonds d’investissement, à qui j’ai parlé de cette idée un peu folle de rassembler des centaines de millions de dollars pour lancer mon propre satellite. À son invitation, j’ai réalisé des slides présentant le projet et il m’a encouragé à poursuivre! Je me suis alors enfermé pendant un mois dans la maison de vacances de mes parents, à Perpignan, pour réaliser le business plan. Sur base de celui-ci, j’ai pu rapidement lever $500.000 auprès de copains dans l’industrie, et la machine s’est mise en route... J’ai voyagé, j’ai initié des campagnes de communication autour du projet... Les opérateurs télécoms des îles du Pacifique ont vite confirmé leur intérêt pour la bande passante que j’allais mettre à disposition, car apparemment personne ne s’intéressait à eux! Puis le business a fait boule de neige jusqu’à la commande à Boeing d’un satellite et l’acquisition en août 2017 de la fusée Falcon 9 de SpaceX. Nous sommes aujourd’hui complètement financés, avec en ligne de mire $600 millions de contrats de clients.»
- Votre satellite Kacific1, avec ses 7 tonnes, est annoncé comme le plus gros satellite commercial jamais lancé !
Ch.P.: «C’est un satellite Boeing 702MP, à deux étages: l’un pour une société japonaise de diffusion télévisée, l’autre que nous avons acheté pour près de $100 millions. Pourquoi est-il si gros? Parce que nous avons rempli les deux étages au maximum des capacités (sourire). Notre étage dédié à l’internet à haut débit, avec 40 Gbps de débit, possède 56 faisceaux haute puissance qui vont couvrir 25 pays: Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mélanésie, Nouvelle-Zélande, Népal... Bref, beaucoup d’endroits très reculés, avec énormément de populations rurales. C’est la première fois qu’une telle technologie est déployée dans cette partie du monde. Le satellite géostationnaire sera positionné au-dessus de l’Asie-Pacifique à 36.000 km de la Terre, avec du carburant pour se garder en position dans l’espace pendant minimum 25 ans.»
- Auriez-vous un message à adresser aux ingénieurs de l’École qui seraient attirés par votre secteur d’activité ?
Ch.P.: «Dans cette région du monde, nous sommes face à une pénurie d’ingénieurs. L’Asie-Pacifique connaît un essor extraordinaire et nous peinons à attirer des talents, surtout au sein d’une start-up, et même si l’espace a un petit côté glamour (sourire). Je serais donc enchanté de recevoir des candidatures issues de l’École. J’y suis passé et je sais que c’est une garantie de qualité.»
Hugues Henry
Ses années Polytech (1987-1992)
Un professeur
«La veille de mon examen de 5e avec le Pr Claus Sieverding, pour le cours de turbomachines, j’avais visité la Sabena avec un ami, mécanicien sur moteur d’avion. J’ai tout restitué lors de l’épreuve! Impressionné, le professeur m’a encouragé à postuler à l’Institut von Karman!»
Un héritage
«Je suis reconnaissant envers l’École. Elle m’a donné tous les outils pour devenir quelqu’un, pour faire valoir mes compétences et pousser les gens à croire en moi dans le milieu industriel. Les bases acquises à l’ULB ont participé à ce que j’ai concrétisé aujourd’hui.»